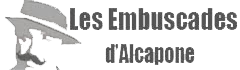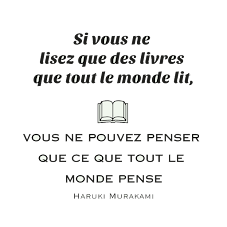"Nous avons besoin d'une critique des valeurs morales, il faut commencer par mettre en question la valeur même de ces valeurs, et cela suppose la connaissance des conditions et des circonstances de leur naissance, de leur développement, de leur modification (la morale comme conséquence, comme symptôme, comme masque, comme tartuferie, comme maladie, comme malentendu; mais aussi la morale en tant que cause, remède, stimulans, entrave ou poison), bref, une connaissance telle qu'il n'en a pas existé jusqu'à présent et telle qu'on ne l'a même pas souhaitée. Car on a considéré la valeur de ces valeurs comme donnée, comme réelle, comme au delà de toute mise en question; jusqu'à présent on n'a pas hésité le moins du monde à donner à l'homme "bon" une valeur supérieure à celle du "méchant", une valeur supérieure dans le sens du progrès, de l'utilité, de la prospérité de l'homme en général (y compris l'avenir de l'homme). Et si le contraire était vrai ? Et s'il n'y avait chez le "bon" aussi un symptôme de régression de même qu'un danger, une séduction, un poison, un narcotique, qui permettrait au présent de vivre en quelque sorte aux dépens de l'avenir, peut-être avec plus de confort, moins de risques, mais aussi dans un style plus mesquin, plus bas?... De sorte que ce serait la faute de la morale si l'espèce humaine n'atteint jamais le plus haut degré de puissance et de splendeur auquel elle puisse prétendre? De sorte que la morale serait le danger des dangers ?" (extrait de l'Avant-propos, p. 14-15). Voilà, ce qui résumerait le mieux l'objet de cet essai de Friedrich Nietzsche...
Prolongeant sa réflexion sur Par delà bien et mal, cet "écrit polémique" met en lumière l'art de la rhétorique du philosophe allemand. Invitant ses semblables à reconsidérer les valeurs morales contemporaines, Nietzsche par une pirouette bien sentie, renverse la donne et interroge sur le bien-fondé de la morale occidentale. Délaissant cette fois-ci ses habituels aphorismes au profit d'un développement sous forme de dissertations, Nietzsche décline sa "Généalogie de la morale" en trois essais :"le bon et le mauvais" (ou la morale des maîtres contre celle des esclaves), "le ressentiment" (ou la mauvaise conscience ou la culpabilité qui forge la morale des esclaves) et "les idéaux ascétiques" (critique de l'ascétisme qui se nourrit de la morale des esclaves)...
Crédit photo : Friedrich Nietzsche, yourbest100.com
Prolongeant sa réflexion sur Par delà bien et mal, cet "écrit polémique" met en lumière l'art de la rhétorique du philosophe allemand. Invitant ses semblables à reconsidérer les valeurs morales contemporaines, Nietzsche par une pirouette bien sentie, renverse la donne et interroge sur le bien-fondé de la morale occidentale. Délaissant cette fois-ci ses habituels aphorismes au profit d'un développement sous forme de dissertations, Nietzsche décline sa "Généalogie de la morale" en trois essais :"le bon et le mauvais" (ou la morale des maîtres contre celle des esclaves), "le ressentiment" (ou la mauvaise conscience ou la culpabilité qui forge la morale des esclaves) et "les idéaux ascétiques" (critique de l'ascétisme qui se nourrit de la morale des esclaves)...
Crédit photo : Friedrich Nietzsche, yourbest100.com
Je ne m'étendrai pas sur l'interprétation de cette Généalogie de la morale car le web fourmille de pistes qui se rejoignent (ou pas). D'ailleurs, mon avis peu éclairé ne serait d'aucune utilité. Mon compte-rendu portera plutôt sur mon expérience de lecture. Nietzsche en est conscient, sa pensée est tortueuse et l'interprétation de ses textes exige un effort, une compétence que ne possède pas à priori l'homme moderne : "savoir ruminer". Certes, il n'a pas tort mais en même temps avouons que le style pamphlétaire du philosophe, ses écrits sibyllins et son esprit d'escalier sont assez éloignés de la pensée systématique généralement associée aux philosophes. En effet, Nietzsche fait plus figure d'un écorché vif que d'un philosophe. Alors c'est vrai, comme le souligne le philosophe allemand : "pour pouvoir pratiquer la lecture comme un art, une chose avant toute autre est nécessaire, que l'on a parfaitement oubliée de nos jours - il se passera encore du temps avant que mes écrits ne soient lisibles -, une chose qui nous demanderait presque d'être de la race bovine et certainement pas "un homme moderne", je veux dire : savoir ruminer..." (extrait de l'avant-propos, p. 17). Mais pas seulement aurais-je envie de dire car si on retourne la question, n'incombe t-il pas aux philosophes (qui se considèrent souvent éclairés) de savoir transmettre clairement les concepts qu'ils ont eux-mêmes élaboré ? Hum... La question est lancée et moi, je retourne à mes ruminations...
Pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite enfin à lire cet excellent billet du Petit Vagabond et si vous êtes tentés par cette lecture, notez que vous pouvez l'acheter sur Amazon via le lien suivant : La généalogie de la morale.
Pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite enfin à lire cet excellent billet du Petit Vagabond et si vous êtes tentés par cette lecture, notez que vous pouvez l'acheter sur Amazon via le lien suivant : La généalogie de la morale.
- Titre : La généalogie de la morale
- Sous-titre : Un écrit polémique
- Titre original : Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift
- Auteur : Friedrich Nietzsche
- Traducteur : Isabelle Hildenbrand et Jean Gratien
- Éditeur : Folio
- Collection : Folio Essai
- Date de parution : Mars 1994 (date de parution originale : 1887)
- Nombre de pages : 212 p.
- ISBN :2-07-032327-7
- Couverture : La croix, Eugen Schönbeck, Musée de la ville de Strasbourg